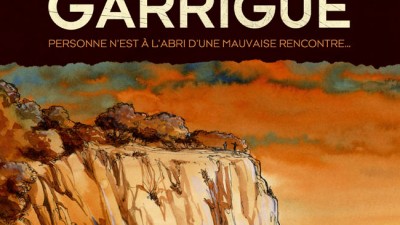Tony Corso
Ne cherchez pas de linéarité dans le parcours d’Olivier Berlion. Loin de s’endormir sur ses lauriers, du Cadet des Soupetard à Histoires d’en ville en passant par Lie-de-vin ou Sales Mioches, l’auteur s’est construit, album après album. Sa détermination et ses convictions dissimulent à peine un auteur par ailleurs ultrasensible, capable de douter mais toujours avec cette énergie que l’on devine précieuse. Gros plan…
Vous avez toujours été attiré par le polar, mais Tony c’est plus que cela, avec une vision du monde sans complaisance… Presque une dénonciation de certaines dérives, non ?
Je ne dénonce pas, j’enfonce des portes ouvertes. Démonstration : de nos jours il vaut mieux être riche et placer son argent plutôt que de bosser nuit et jour pour faire fortune, n’importe quel conseiller financier un peu finaud vous le confirmera.
Nos démocraties sont désormais aux mains de groupes d’actionnaires ou fonds de pensions pour retraités par définition sans avenir, sans territoire, souvent exempts d’impôts. De temps à autre, comble du cynisme, on nous sort du chapeau une personne partie de rien, devenue star du jour au lendemain d’un coup de baguette magique : « Ah ! Vous voyez ! Ca peut arriver à tout le monde bande de feignants inflexibles ! ». Je pense évidemment aux stars de télé réalité, aux gagnants du loto, aux stars du football… des alibis... Un type comme Berlusconi, et je salue les Italiens au passage pour leur sens de l’humour, prend en otage un pays entier pour faire tourner son business et se débarrasser de tous les procès qui le menacent. Je peux continuer pendant des heures mais je sens que je fatigue déjà tout le monde… C’est comme ça à notre époque. Faut pas se prendre la tête, de toute façon on a pas trouvé moins pire.
Alors voilà comment j’en suis venu à imaginer Tony Corso, le privé de la jet-set. Essayer d’effleurer tout ça sans prendre la tête. Légèreté, légèreté ! Distraire plutôt qu’assommer. Du coup je m’amuse comme un petit fou à caricaturer la planète fric, montrer sa vanité, son absurdité.
On découvre aussi un certain cynisme plutôt bien distillé…
Merci… L’univers de la jet-set, des milliardaires repus et paranoïaques n’a rien de glorieux. Je ne veux surtout pas mettre en valeur ces gens-là, mais au contraire faire apparaître sous le vernis la pitoyable existence à laquelle ils se sont condamné eux-mêmes en tentant de se hisser au-dessus des autres.
Mon personnage se balade dans ce panier de crabes sans jamais se faire avoir par l’illusion. En un sens, il est pour moi un héros moderne, car plutôt que de se tenir sur le côté en criant à l’injustice dans l’indifférence générale il s’adapte au système, le détourne à son profit et tente, quand il le peut, de rétablir l’équilibre. Sa devise : « il faut prendre l’argent où il est », est un pied de nez à tous les individus qui place leur pognon en bourse en espérant multiplier les pains sans se soucier de savoir si cette miraculeuse plus-value s’est faite sur le dos d’un petit Indonésien, où au détriment d’une forêt tropicale. Tony s’enrichit sur le dos des riches, quoi de plus normal.
Dans le second tome, vous êtes par exemple plutôt sans pitié avec une pseudo star de la chanson, fabriquée (et utilisée) de toute pièce. C’est criant de vérité !
Dustin est la quintessence du système, aucune culture, aucun talent, grossier, invivable, mais tout le monde le supporte car il représente beaucoup d’argent. J’ai plutôt de la sympathie pour ce personnage manipulé. Il me touche quelque part, car il ne triche pas, même quand il chante comme une casserole c’est avec tout son cœur. Tony lui balance ses quatre vérités sans pour autant l’humilier et c’est une attitude beaucoup plus noble que celle adoptée par un grand nombre de commentateurs, animateurs, journalistes ou autres envers ces paumés de la société-spectacle.
Cette série n’est-elle pas tout simplement un aboutissement de tout ce que vous vouliez raconter et dessiner ?
Tony Corso est en tout cas mon projet le plus ambitieux à ce jour. Cette série me permet de conjuguer tous ce qui m’a poussé gamin à vouloir devenir auteur de BD. Et pour moi, cela voulait dire bien évidement texte et image. Longtemps j’ai été complexé par mon dessin, aujourd’hui encore… et je me suis donc concentré essentiellement dessus au début de ma carrière. De plus j’ai eu la chance de rencontrer un scénariste de talent en la personne de Corbeyran qui m’a offert de magnifiques récits. Mais je n’ai jamais perdu de vue qu’un jour je serai auteur complet d’une série avec un héros récurrent et populaire comme les héros de mon enfance (Jérémiah, Blueberry, Bernard Prince et plus jeune Les Tuniques bleues ou Gil Jourdan…). Je m’y investi totalement, jours et nuit. J’aime ce personnage totalement libre, j’adore le mettre en scène, le faire parler, vivre toutes sortes de situations, slalomer en toute décontraction au cœur d’un univers cynique et illusoire. On me fait parfois le reproche de faire une BD commerciale par comparaison avec mes autres œuvres dites « d’auteur », alors que jamais je n’ai été aussi en accord avec moi-même, mes envies, ma vision du monde, jamais je ne me suis autant amusé.
Il s’agit d’une véritable démarche d’auteur. Mais pas forcément là où certains vous attendaient…
Ma seule ambition est de raconter des histoires qui me plaisent, le graphisme étant un support à cet objectif, d’où mon changement de style en fonction des univers abordés. Il n’y aurait pas pire pour moi que d’être condamné à dessiner toute ma vie des histoires de paysans, sous prétexte que je dessine bien les vaches.
J’ai tout entendu sur mon travail et longtemps je me suis laissé influencer par ce flot d’avis souvent contradictoires et puis il y a eu Lie-de-vin et là on m’a dit « ça c’est ton truc ». Normal ça marchait. Ah bon ? Je m’interroge. C’est quoi mon truc exactement ? Je ne savais pas que j’avais un truc. Je fais Histoires d’en ville chez Glénat. Les professionnels l’ignorent : ça ne devais pas être mon truc. Pourtant qu’est-ce que je l’aimais cette histoire ! Et puis je fais Cœur Tam-Tam avec Benacquista, encore différent, et là c’est à nouveau mon truc même si cela n’a rien à voir avec Lie-de-vin. Alors au bout du compte, je me suis dis que j’allais faire mes trucs. Et j’ai imaginé Tony Corso, et je continue à faire des one shot tourmentés et je vais refaire des BD pour enfants et la vie est belle à ne pas rester les deux pieds plantés dans son truc à se répéter indéfiniment au risque de mourir d’ennui.
On sent un soin particulier apporté aux dialogues. Est-ce un aspect que vous travaillez beaucoup ?
Je travaille surtout la fluidité du récit. Je ne veux pas qu’un lecteur s’ennuie en me lisant et les dialogues ont évidement une part importante dans cette démarche : il permettent d’introduire de la distance dans une situation tendue, d’aborder avec légèreté un sujet sensible, de faire passer une idée sans se lancer dans un débat de fond ou rythmer une scène un peu statique. C’est un équilibre. Les dialogues ne sont que le sommet de l’iceberg. Avant chaque réplique il y a d’abord un personnage construit avec précision, son passé, ses goûts, son rôle dans le récit. Ensuite, je n’ai qu’à me laisser porter par son caractère et il parle de lui-même.
Votre collaboration avec Benacquista (1), pour qui les dialogues comptent énormément, a-t-elle été profitable à ce niveau ?
Avec lui comme avec Corbeyran, j’ai beaucoup appris. Tonino m’a permis de me débarrasser des effets de styles, car il ne cède jamais à ce genre de facilité.
Pour lui un bon dessin ou un bon dialogue doivent informer, faire avancer la trame de l’histoire, sinon ils n’ont aucune utilité.
Avec Corbeyran j’ai appris à construire une scène, à charpenter une histoire, à ménager les rebondissements, etc. Ce sont deux grands professionnels de la narration et j’essaie de me hisser à leur niveau.
Avec Tony Corso, vous expliquiez vouloir revenir aux fondamentaux du dessin sans vouloir vous en remettre uniquement à la couleur directe. Pourtant ce style de dessin pourrait paraître plus « simple » au premier abord au lecteur.
Le dessin, vaste débat… Longtemps, à cause de mes complexes en dessin, j’ai cherché à en mettre plein la vue. Mais toute cette débauche d’effets ne faisait que masquer mes faiblesses. Un moment, je me suis dis qu’il n’était pas honnête envers moi-même de me cacher derrière des petits effets graphiques, d’où ma décision de reprendre la technique du dessin au trait noir, classique et juste. Un dessin entièrement au service de mon propos, ne cédant rien aux envolées graphiques inutiles. J’ai réappris à dessiner une oreille correctement, j’ai ressorti mes planches d’anatomie, appris à dessiner des femmes, bref j’ai redécouvert le plaisir de dessiner, observer, sans tics et sans manies. Je me suis réconcilié avec mes envies de gamins de mettre en scène la réalité, sans limite.
Je me souviens vous avoir entendu parler avec admiration de grands dessinateurs injustement sous-estimés sous prétexte qu’ils étaient des adeptes du dessin réaliste. Vous avez toujours cette même sensation ?
J’ai dessiné dans tous les styles, pour enfants, humour, couleur directe, « nouvelle vague », rien n’est aussi difficile et impitoyable que le dessin réaliste. Impitoyable car cela demande un boulot phénoménal pour une reconnaissance dérisoire et la moindre faute sur un visage ou sur une perspective fout en l’air toute votre page.
Longtemps moi aussi, j’ai tenu ce discours de petit con complexé, suivez mon regard, cherchant à masquer ses lacunes en dénigrant le travail des auteurs classiques. Depuis, conscient de cette abnégation qu’exige le dessin réaliste je redécouvre avec révérence l’immense travail de ces auteurs qui, modestement, consciencieusement, mettant leur ego de côté, ont donné vie à des récits riches, denses et m’ont transporté à travers le monde et l’histoire.
Pour en revenir au discours lénifiant sur le dessin en BD, j’entends dire très souvent : « Je ne lis pas cette BD parce que je n’aime pas le graphisme. » C’est le degré zéro de l’intelligence. Pour moi ce genre de position est aussi stupide qu’un type qui ne va pas voir un film avec Woody Allen parce qu’il n’aime pas sa tête ou qui ne vote pas machin parce qu’il a un petit air sournois. Si j’avais eu ce genre de raisonnement plus jeune, je serai passé à côté de génie comme Baru, Tardi où Vuillemin car je lisais des BD dites classiques.
Autre exemple, quand j’ai débuté au début des années 90, les éditeurs, les journalistes, les libraires, les auteurs, se pinçaient le nez en parlant des mangas, de ces dessins sans âmes faits par des studios. Depuis, les ventes ont explosées, les gamins ne lisent plus que ça, les professionnels s’extasient et Taniguchi a reçu le Prix du meilleur dessin à Angoulême. Amusant…
En ce sens, tous les discours autour du graphisme en BD sont creux. Un bon dessin c’est celui qui sert au mieux une histoire, le reste n’est que mode, petits fours et compagnie.
N’avez-vous parfois pas l’impression d’être mieux compris des lecteurs que de certains professionnels ?
Les professionnels, m’ouais. En tout cas, si vous n’avez pas de lecteur j’ai constaté que les professionnels ont vite fait de vous oublier. C’est mécanique. Certains auteurs adulés dans les années 80 ou 90 sont totalement ignorés aujourd’hui car ils n’ont pas eu la chance de rencontrer un public large. En revanche certains auteurs que ces experts professionnels méprisaient ont explosé leur ventes et depuis le regard sur leur travail est devenu beaucoup plus compréhensif, comme par magie. La BD c’est comme le cinéma, la télé, la littérature, soi-disant sympa, mais totalement hypocrite. En quinze ans de métier j’ai entendu un paquet d’horreurs entre deux verres de pinard sur tel ou tel auteur. Je me souviens de mon premier festival ou, naïvement, je parle de mon attachement à la série Les Tuniques bleues de Cauvin et Lambil. Une série qui m’a vraiment bercé toute mon enfance. Rires moqueurs d’une brochette d’auteurs. Sans donner de nom, je peux juste vous dire que deux d’entre eux n’ont pas trouvé mieux pour ne pas crever de faim que de reprendre des séries déjà existantes et les autres ont sombré dans l’oubli. De même il faut savoir que systématiquement lorsque vous croisez un professionnel, il vous demande ce que vous faites, au cas où il risquerait de se compromettre avec un looser. C’est la petite comédie humaine, comme partout.
Il faut seulement savoir lorsque vous êtes en haut de l’affiche que vos nouveaux amis ne sont la plupart du temps là que pour apparaître sur la photo. Au moindre passage à vide, ils s’empresseront de suivre un autre cheval et vous vous retrouverez seul dans la plaine avec deux ou trois fidèles compagnons. S’accrocher à la reconnaissance des « professionnels » est un leurre extrêmement dangereux pour son équilibre mental. C’est un sport de tous les jours qui n’engendre qu’insatisfaction. La plus belle reconnaissance est celle d’un lecteur qui vous demande avec des lumières plein les yeux quand paraîtra la suite des aventures de votre héros.
Je sais que votre prochain album (qui paraîtra dans la collection « Long Courrier » en 2007) vous tient très à cœur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
C’est une magnifique histoire écrite par Corbeyran : Rosangela, une femme battue prend sa revanche et solde son passé douloureux. C’est beau, à cent lieux de tout manichéisme, juste, profond et touchant. Je suis très fier et très angoissé d’avoir la responsabilité de mettre des images sur ces personnages. J’espère que le public partagera notre enthousiasme. Si je ne me casse pas la main, l’album devrait sortir début 2007 entre deux Tony Corso.
Sinon, vous passez vos vacances à Saint-Tropez ? (Rires)
Bien entendu ! Dans ma villa sur les hauteurs, au bord de ma piscine à débordement je tiens salon tout l’été. Je reçois tout le gratin de la jet-set et je claque mes droits d’auteurs en distribuant de la coke et du champagne !!!
François Le Bescond
(1) Cœur Tam-Tam, Dargaud